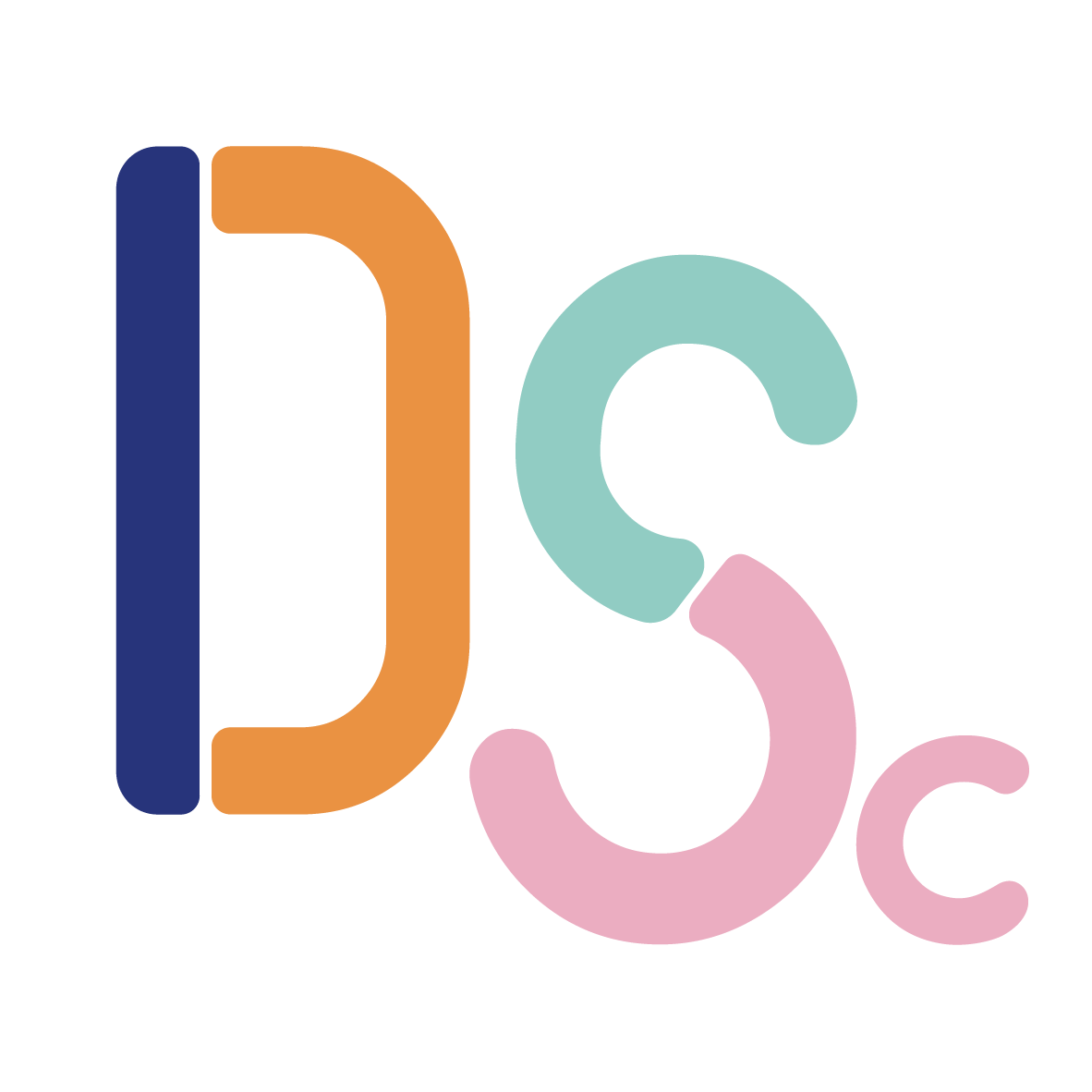Pour citer cette page : Roelants D. et Dahmouche H. (2025). L’usage des analogies en sciences. DidacSciences. https://didacsciences.be/.
Introduction et balises
Dans la pensée humaine, l’analogie est omniprésente. Notre vie quotidienne est ponctuée de situations nouvelles auxquelles nous devons faire face. L’analogie nous permet de les appréhender en les traitant comme des situations connues (Sander, 2000[1]).
Dans l’enseignement des sciences, l’analogie est régulièrement convoquée pour aider les élèves à comprendre des concepts abstraits ou complexes. En mobilisant des connaissances familières pour éclairer ceux-ci, elle pourrait constituer un puissant levier cognitif. D’après Glynn (1998)[2], elle faciliterait la construction de représentations mentales en mettant en relation un domaine source connu et un domaine cible à découvrir. Ainsi, comparer la cellule et ses fonctions à une usine ou encore le courant électrique à l’écoulement de l’eau dans un tuyau permet de rendre tangible une réalité non perceptible. En quelque sorte, l’analogie transforme les concepts en éléments “observables” (Rumelhard, 2011). Toutefois, l’usage de l’analogie en classe n’est pas toujours pertinent (par exemple si on tente d’expliquer la structure atomique avec le système solaire). Rumelhard (1988, p.37) propose à ce propos une typologie de situations pour lesquelles il paraît porteur de procéder par analogie. L’emploi d’analogies ne va pas non plus sans difficultés pour les élèves. Plusieurs travaux, notamment ceux de Vergnaud pour les mathématiques ou de Tiberghien (1994[3]) pour la physique, soulignent que les élèves peuvent retenir des aspects inappropriés du modèle ou surestimer la similarité entre les deux domaines. Le rôle de l’enseignant devient alors crucial pour guider l’interprétation et expliciter les limites de l’analogie. En effet, comme le rappelle Clement (1993)[4], une analogie mal maîtrisée peut induire des conceptions erronées durables. D’autres auteurs comme Hammadou (2000[5]) ont révélé que l’utilisation d’analogies peut avoir un effet négatif sur la compréhension, notamment lorsque le niveau de compétence linguistique est faible ou lorsque les connaissances préalables sont insuffisantes alors qu’une bonne maîtrise de la langue et des connaissances préalables solides peuvent atténuer ces effets négatifs et favoriser ainsi une meilleure compréhension.
Selon le domaine de la psychologie cognitive, l’analogie constitue un processus central de la pensée. Pourtant, des recherches ont montré des résultats contrastés vis-à-vis de l’efficacité de ce processus sur les apprentissages (Dachet, Faulx & Baye, 2020[6]). Dans ce contexte, il est essentiel de s’interroger sur les conditions didactiques qui permettent un usage efficace des analogies, en particulier à l’école primaire et au collège, où les représentations initiales des élèves ont encore une place prépondérante. Il est crucial de s’interroger sur la valeur heuristique de l’analogie; en quoi elle permet une compréhension de l’élément étudié tout en amenant une réflexion sur les limites dans l’explication. Les ressources fournies ci-après vous permettront d’explorer ces questions.
Entrées faciles
Le manuel analogique : un pas en avant dans la pédagogie des sciences de Bean, Singer et Cowan (1986) défend l’idée de l’efficacité des analogies dans les apprentissages en sciences. Plusieurs exemples viennent éclairer le propos.
Dans leur ouvrage Pédagogie, dictionnaire des concepts clés (2014)[7], Raynal et Rieunier abordent la notion d’analogie dans le cadre de la psychologie cognitive et de l’apprentissage. Ils soulignent que le raisonnement analogique est un outil puissant pour la pensée, permettant de transférer des connaissances d’un domaine à un autre. Cependant, ils mettent également en évidence les défis associés à l’utilisation des analogies
L’ouvrage “100 analogies étonnantes pour comprendre les grandes théories scientifiques” de Levy (2012[8]) propose des métaphores et des comparaisons pour décrire les concepts et théories scientifiques majeurs. Les analogies sont étayées et illustrées par des faits, des chiffres et des schémas dans des domaines variés.
L’ouvrage de Darwin « L’origine des espèces » (1859)[9] montre un cas de raisonnement analogique, entre la sélection naturelle et la sélection artificielle. Il prend entre autres l’exemple du pigeon (p.131-132).
Écrits scientifiques
Généralistes
L’article de Rumelhard (2011), plus général, traite de la formation des concepts et discute notamment de l’imagination analogique qui précède celle-ci.
En physique
L’article de Dachet, Faulx & Baye (2020) aborde la question des analogies dans le cadre de l’apprentissage en classe de sciences en fin de secondaire (Belgique). Cette étude expérimentale compare l’impact de l’utilisation de différents types d’analogies ou de supports pédagogiques sur trois dimensions cognitives : mémorisation, compréhension et transfert. Celle-ci porte sur le concept-cible de fission nucléaire.
L’article de Lancor Anderman (2014) montre comment la demande d’analogie auprès d’étudiants de l’enseignement supérieur permet d’inférer sur leurs conceptions sur la notion d’énergie (ex : la métaphore hydraulique). L’article est susceptible d’orienter la formation de futurs enseignants.
En biologie et SVT
Ravachol (2016) questionne la place de la modélisation analogique dans l’enseignement des sciences et vie de la Terre. Elle compare le statut de ces modèles employés en classe à celui des modèles employés par les scientifiques.
Crépin-Obert (2014) questionne l’analogie à la fois en tant qu’obstacle épistémologique et en tant que raison scientifique pour enseigner la parenté et la filiation entre les êtres vivants fossiles et actuels de l’école primaire à l’université.
L’étude de Gineste et Gilbert (1995) se penche sur l’utilisation de l’analogie comme moyen pour appréhender des domaines non observables directement. Deux thèmes sont étudiés avec des élèves de 10-11 ans : les constituants de la cellule et les échanges gazeux dans le sang.
L’article de Crépin-Obert (2011) propose une discussion sur le raisonnement par analogisme dans le cadre de la construction du concept de fossile qui peut à la fois faire levier d’apprentissage mais aussi constituer un obstacle dans le raisonnement.
En langue anglaise, Bean et al. (1990) étudient l’impact d’une analogie combinant image et partie textuelle sur la compréhension du concept biologique de cellule.
Quelques analogies en biologie sont discutées pour leur fonction de modèle dans l’article de Rumelhard (1988) que nous avons évoqué dans l’introduction.
L’article de Mein (1988) montre que l’évolution des conceptions sur le cerveau durant l’histoire est parfois fondée sur des analogies plus ou moins pertinentes (modèle hydraulique ; modèle électrique ; cerveau-ordinateur ; etc.).
En chimie
Dehon et Snauwaert (2018) proposent un article intéressant à propos de l’analogie entre l’alphabet de la langue française et la chimie. Ils soulignent les spécificités de la langue symbolique des chimistes et proposent des pistes didactiques pour la pratique de classe.
En numérique
Dans le domaine du numérique, l’article de Michel et Sperandio (1996) présente une démarche d’utilisation d’analogies dans le cadre d’une introduction à la programmation à des étudiants d’une filière non-scientifique à l’université (France).. Ces analogies avaient pour but de leur fournir un outil de représentation d’un dispositif informatique. Une introduction intéressante présente une typologie d’analogies mobilisées dans les apprentissages.
Pour aller plus loin et en chimie : Bachelard (1932; p.30-33 ; p.121) évoque aussi le rôle des analogies dans l’histoire de la chimie qui se sont parfois posées en obstacles à la constitution d’une chimie scientifique. Par exemple, la conception aristotélicienne consistait à attribuer à l’infinie variété des phénomènes une infinité de « figures ».
Pistes de réflexion pour les TFE et mémoires
Questionner ce sujet, c’est par exemple :
- interroger les conditions didactiques permettant un usage efficace et pertinent des analogies ;
- s’intéresser à la nature des analogies employées en classe de sciences ;
- investiguer les difficultés des élèves lors d’un recours à un raisonnement analogique ;
- mettre en évidence les leviers amenés par les analogies ;
- étudier l’impact de l’utilisation d’analogies sur la mémorisation ou la compréhension des concepts ;
- etc.
[1] Sander, E. (2000). L’analogie, du naïf au créatif: analogie et catégorisation. Éditions L’Harmattan.
[2] Glynn, S. M. (1998). The teaching-with-analogies model: Build conceptual bridges with mental models. Journal of Research in Science Teaching, 35(10), 1129–1149
[3] Tiberghien, A. (1994). Modeling as a basis for analyzing teaching-learning situations. Learning and Instruction, 4(1), 71-87
[4] Clement, J. (1993). Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students’ preconceptions in physics. Journal of research in science teaching, 30(10), 1241-1257.
[5] HAMMADOU J. (2000). «The impact of analogy and content knowledge on reading comprehension: what helps, what hurts». The Modern Language Journal, 84, 38-50.
[6] Dachet, D., Faulx, D., & Baye, A. (2020). Quels impacts du recours à l’analogie sur la mémorisation, la compréhension et le transfert d’un concept nouveau? Étude expérimentale dans les classes de sciences. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, (207), 95-117.
[7] Raynal, F., & Rieunier, A. (2014). Pédagogie : Dictionnaire des concepts clés. Apprentissage, formation, psychologie cognitive. ESF Sciences Humaines.
[8] Levy (2012). 100 analogies étonnantes pour comprendre les grandes théories scientifiques. Le courrier du livre.
[9] Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection. John Murray.