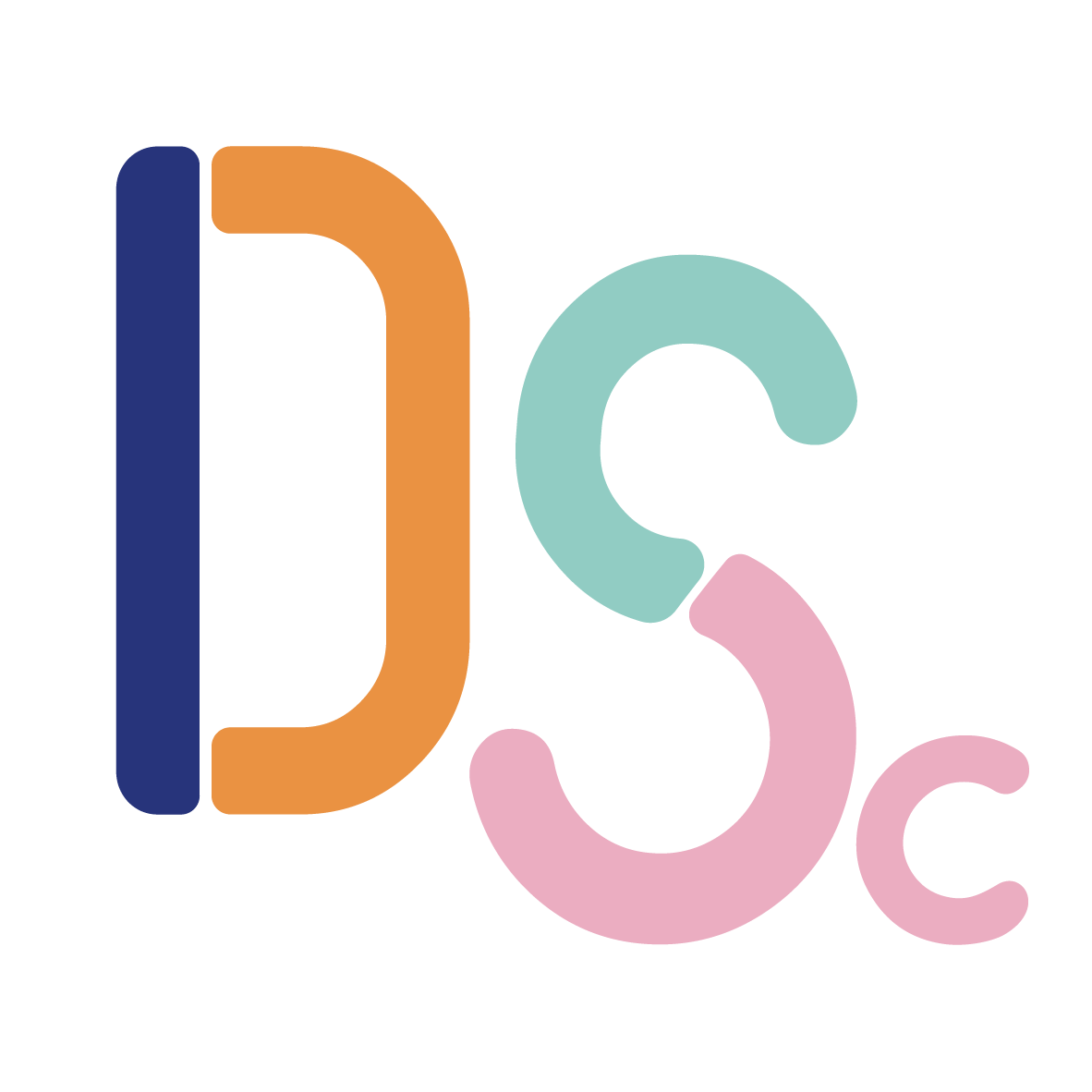Pour citer cette page : Roelants D. (2025). La recherche documentaire en sciences. DidacSciences. https://didacsciences.be/.
Introduction et balises
De nombreux enseignants ont recours à des textes informatifs pour accompagner les activités de classe (Ziarko & Pierre, 1993). Cette utilisation de documents, qu’ils soient numériques ou papiers, se fait au service des apprentissages disciplinaires en permettant un accès aux savoirs.
La lecture documentaire est pourtant aussi elle-même objet d’apprentissage dans le sens où décoder des textes demande aux élèves de mobiliser diverses compétences qui sont loin d’être innées (Jaubert, Rebière et Guillou-Kérédan, 2014[1]). L’exploitation des textes documentaires pose de ce fait des difficultés aux élèves car ce travail implique à la fois l’acculturation à l’écrit scientifique documentaire (et donc à ses codes particuliers) mais aussi à la construction de savoirs à partir d’un discours scientifique impliquant un rapport au réel pour penser le monde (Bisault (2008); Renaud et Magneron, 2012[2]). Alors que les difficultés pour lire et comprendre les textes documentaires sont bien identifiées, les compétences requises sont très peu enseignées et la lecture de ces textes fait rarement l’objet d’un enseignement-apprentissage à l’école. Des nombreuses études relatent ce constat (Andreu, Dalibard & Étève, 2016; Bautier et al., 2012; Colmant & Le Cam, 2017 ; De Croix, 2016[3] ; Jaubert, 2016[4]; Rémond, 2006). D’autres dénoncent des «stratégies inexistantes» pour traiter les textes documentaires malgré leur place majoritaire à l’école, notamment dans la lecture pour apprendre (Ziarko & Pierre, 1993[5]).
L’enjeu à l’école est donc d’apprendre aux élèves à développer leur autonomie dans l’appropriation des savoirs au départ des textes documentaires en articulant “l’apprendre à lire” et le “lire pour apprendre”.
Ce sujet étant en lien avec le langage, vous trouverez des ressources intéressantes sur la page Langage.
Entrées faciles
Le dossier “Apprendre à chercher, chercher pour apprendre”[6] dans les Cahiers pédagogiques (508) est consacré aux compétences documentaires des élèves et à leur développement (recherche, évaluation et exploitation). Diverses contributions de chercheurs et enseignants éclairent la question.
Le guide pédagogique “Suggestions de pratiques d’enseignement favorables à la lecture chez les élèves du secondaire” (Grunderbeeck et al., 2004) vient en réponse à une vaste recherche portant sur le développement des habitudes et des compétences en lecture au Québec dans les milieux précarisés. Il apporte aux enseignants des repères sur les stratégies d’intervention et sur les pratiques d’enseignement favorables. La chapitre 2 est consacré aux textes documentaires. Il est accessible sur la page de site web dans la partie “Stratégie d’intervention – Agir autrement”.
Le dossier n°65 du CEPEC coordonné par Simonard (2000) propose des points de repères à propos de la lecture et de l’écriture de textes documentaires. Illustrées par de nombreux exemples de séquences d’apprentissage, les différentes parties de ce dossier proposent une réflexion sur les démarches et connaissances à construire pour aider les élèves à mieux exploiter ces ressources. Il s’agit d’une ressource intéressante et plutôt complète pour entrer dans le sujet.
L’ouvrage de Nonnon et Quet (2012)[7] fait le point sur les évolutions liées aux activités de lecture pour apprendre et comprendre. Il reprend diverses interventions permettant de cerner les enjeux et les obstacles mais aussi de mettre en évidence des pratiques de classe permettant de développer des connaissances et une réflexion sur le monde.
Écrits scientifiques
Généralistes
L’article de Renaud (2020) questionne les stratégies à enseigner pour l’apprentissage de la lecture documentaire et propose un outil didactique pour aider à développer ces compétences chez les élèves du primaire.
Les notes d’experts du CNESCO (2016) à propos du développement des compétences de lecture dans les différentes disciplines proposent des outils de réflexion intéressants. La note de Jaubert (pp. 84-94) propose d’interroger les pratiques pour soutenir les apprentissages en lecture dans les disciplines scolaires, notamment les sciences. L’article de De Croix (pp.95-103) identifie les spécificités des textes informatifs pour formuler des repères pour la pratique pour le secondaire.
Dans la note de conférence “Quelles pratiques enseignantes pour soutenir l’apprentissage continu de la lecture dans les disciplines scolaires ?” (Dossier p.86), Jaubert (2016) interroge la lecture documentaire et met en évidence les difficultés rencontrées par les élèves dans la compréhension de ces textes tant au niveau de la maîtrise de la langue que de la dimension culturelle. Des propositions de travail avec les élèves sont formulées.
La note de conférence De Croix (2016) questionne l’intérêt et la façon d’apprendre à lire des textes informatifs au début du secondaire. Elle identifie notamment les spécificités de ces textes, les modalités de lecture en jeu et propose des repères didactiques.
L’article de Bautier (2015) traite des inégalités sociales pouvant naître de situations où les élèves sont confrontés au traitement de documents complexes visant la construction de savoirs et proposés dès l’école maternelle.
L’article de Nonnon (2012) se penche sur la dimension épistémique de la lecture et sur la construction de connaissances à partir de l’écrit. Il interroge les enjeux, les obstacles et les apprentissages en jeu.
Un autre article Bautier (2012) analyse de façon plus générale les divers outils de la littératie scolaire susceptibles de mettre les élèves en difficulté. Les manuels et documents en sciences sont explorés.
L’article de Dinet et Passerault (2004) examine la recherche documentaire informatisée (RDI) sous l’angle des processus psychologiques qui la sous-tendent.
En lien avec les apprentissages des sciences
La recherche de Renaud et Magneron (2022) propose de mettre en lumière les savoirs implicites de manuels scolaires utilisés comme ressources en classe de fin de primaire (cycle 3, France) pour un apprentissage sur le thème des mélanges et solutions.
La contribution de Jaubert, Rebière et Guillou-Kérédan (2014) s’intéresse aux processus mis en œuvre par des élèves de maternelle (petite section, France) pour affronter un document de type informatif lors d’une activité liée à un élevage d’escargots.
La recherche de Boyer (2014) présentée lors des 8° rencontres scientifiques de l’Ardist analyse des démarches de type enquête en pédagogie Freinet en fin de primaire et début du secondaire (cycle 3, France) qui mobilisent la recherche documentaire comme outil de résolution.
La thèse de Plé (2013) questionne le manuel scolaire en sciences à l’école primaire, ses usages et le lien avec la construction d’un rapport second au monde. L’article propose de fournir des outils pour concevoir des appuis didactiques liés à l’exploitation des manuels.
La recherche de Avel et Crinon (2012) a pour objet la lecture de textes informatifs relevant du genre journalistique ou du documentaire scientifique en vue de résoudre un problème scientifique autour du concept de pollution thermique en classe primaire (CM1 et CM2, France). La démarche s’inscrit dans une démarche de construction de connaissances et compétences scientifiques durant laquelle les élèves produisent des écrits et débattent collectivement.
Dans l’article de Bisault (2008), il est question du rôle du langage dans une séquence d’investigation expérimentale sur le thème du brouillard en primaire (cycle 3). Durant cette séquence, les élèves sont amenés à identifier la nature physique du brouillard ainsi que son mécanisme de formation. L’auteur met en évidence la difficulté des élèves à mettre en relation les informations implicites des documents qui vient s’ajouter aux difficultés liées à la lecture elle-même.
L’étude de Marin, Crinon, Legros & Avel (2007) s’intéresse aux difficultés de compréhension des textes scientifiques et cherche à évaluer l’effet d’aides proposées par l’enseignant. L’étude a été menée avec des élèves de primaire (CM2, France) et à propos d’une séquence sur le dérèglement climatique.
L’article de Froger (2003) montre le travail avec des ressources documentaires pour mener une investigation avec des élèves de primaire de 9-11 ans (CM1-CM2, France) sur le système solaire et l’univers en général.
L’étude de Bondel (2000) a pour objet l’analyse de la façon dont les élèves du secondaire (Lycée, France) utilisent le web pour des recherches documentaires en sciences dans le domaine de l’énergie.
L’article de Garcia-Debanc (1988) s’intéresse à la production d’explications écrites par les élèves. L’auteur propose une analyse de séances de productions de textes explicatifs mais également des temps d’observation de ce type de texte par les élèves afin d’en dégager des caractéristiques.
Pistes de réflexion pour les TFE et mémoires
S’intéresser à la lecture documentaire dans le cadre des apprentissages en sciences, c’est par exemple :
- questionner le rapport des élèves aux écrits documentaires ;
- se pencher sur les difficultés des élèves à construire les savoirs au départ des textes documentaires ;
- réfléchir à l’intégration de textes documentaires dans le cadre d’une démarche d’investigation ;
- interroger les procédures mobilisées par les élèves pour exploiter un texte documentaire en sciences ;
- investiguer sur les démarches permettant d’acculturer les élèves aux écrits documentaires ;
- interroger les spécificités des écrits documentaires et formuler des pistes de pratiques permettant de les dégager avec les élèves;
- etc.
[1] Jaubert, M., Rebière, M., & Guillou-Kérédan, H. (2014). S’essayer à utiliser un texte documentaire en petite section. Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle, (50), 35-56.
[2] Renaud, J., & Magneron, N. (2022). Entre lire et apprendre en sciences à partir de textes documentaires: des savoirs visibles et invisibles. Une étude de cas sur mélanges et solutions dans quatre manuels de cycle 3. RDST. Recherches en didactique des sciences et des technologies, (26), 53-82.
[3] De Croix, S. & Ledur, D. (2016). Nouvelles lectures en jeu. Comprendre les difficultés de lecture et accompagner les lecteurs adolescents. UCLouvain.
[4] Jaubert, M. (2016, March). Quelles pratiques enseignantes pour soutenir l’apprentissage continu de la lecture dans les disciplines scolaires. In Conférence de consensus. Lire, comprendre, apprendre: comment soutenir le développement de compétences en lecture? Notes des experts (pp. 84-94).
[5] Ziarko, H., & Pierre, R. (1993). Types de lectures et compréhension des textes informatifs. L’hétérogénéité des apprenants: un défi pour la classe de français, Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 121-128.
[6] Heurdier-Descamps, L. & Zarkhartchouk, J.-M. (2013). Apprendre à chercher, chercher pour apprendre. [Dossier]. Cahiers pédagogiques, 508, 10-56.
[7] Nonnon, É., & Quet, F. (2012). Oeuvres, textes, documents: lire pour apprendre et comprendre à l’école et au collège. ENS Éditions.